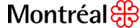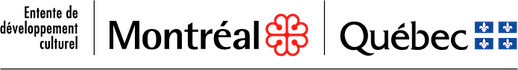Les saisons enracinées |
Les saisons enracinées est un projet de médiation culturelle qui explore la nature urbaine de proximité pour faire découvrir le vivant qui nous entoure et engendrer des récits. Mené par le Théâtre du Renard en partenariat avec le Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun, il s’est déployé du printemps à l’automne 2024, touchant 26 participantes et participants, principalement des personnes nouvellement arrivées au pays, basées dans l’arrondissement de Verdun.
Imaginé par l’artiste et pédagogue Antonia Leney-Granger, également directrice du théâtre, ce projet mise sur la transmission de connaissances écologiques couplées à des activités de créations artistiques. Dans le but de s’imprégner de la nature, il s’agissait de prendre un temps d’arrêt en petit groupe, dans une ambiance chaleureuse et ludique, pour s’intéresser à l’environnement, partager les expériences, puis créer et écouter les histoires.
L’origine multiculturelle des personnes participantes a permis de faire émerger différentes connexions à la flore et à la faune. Le recrutement a bénéficié d’un partenariat avec le Centre de service et d’aide aux immigrants (CSAI) de Verdun. Outre le Québec, 5 pays étaient représentés (Ukraine, Cuba, Algérie, France, Pakistan) par des adultes âgés de 19 à 65 ans. Certains parents sont venus accompagnés de leurs enfants.
Six ateliers ont eu lieu de juin à octobre 2024, pour suivre le fil des saisons. Des balades en nature urbaine, principalement au bord du fleuve Saint-Laurent à Verdun, nourrissaient des jeux créatifs basés sur le théâtre d’objets et les arts visuels. Du côté du parc Angrignon, une visite géologique aux côtés d’une chercheuse invitée s’est terminée par un atelier sur les strates du parcours de vie.
Connecter avec la nature urbaine avait un aspect apaisant. L’imitation du chant des oiseaux, l’identification d’espèces végétales, les dégustations, la découverte des liens entre arbres et champignons stimulaient le partage des récits ainsi que les moments de réflexion ou d’échanges.
VUES DE L’INTÉRIEUR
Nous avons posé six questions à Antonia Leney-Granger, idéatrice du projet, afin d’en savoir davantage sur son expérience.
Montréal – Médiation culturelle : Comment l’idée du projet a-t-elle émergé ?
Antonia Leney-Granger :
Le projet Les saisons enracinées émerge d’un précédent projet artistique créé en 2022-23 : le balado Enracinés – Récits de nature. Chaque épisode allie narration poétique et vulgarisation scientifique afin de faire découvrir la biodiversité urbaine aux auditeurs : insectes, neige, champignons, roches, animaux… J’ai vraiment adoré créer le balado, à la fois parce que j’ai découvert un nouveau médium et parce que ça m’a permis de partager mon amour pour la nature urbaine avec un public très diversifié.
Mais en tant que créatrice de théâtre, la rencontre avec le public me manquait. Je ressentais un besoin de communauté, de discuter des questions que le balado soulève avec d’autres humains. Je rêvais d’un projet où la nature serait une porte d’entrée pour la création des nouveaux récits dont on a tant besoin pour inventer le monde de demain. Et j’avais envie de les créer avec des gens qu’on invisibilise souvent dans les discussions et décisions climatiques. C’est ainsi que l’idée de créer un projet de médiation culturelle autour de la nature urbaine pour un groupe d’adultes immigrants, en collaboration avec le Quai 5160 et le Centre social d’aide aux immigrants de Verdun, a germé.
Mtl-MC : Quels étaient vos rôles et responsabilités à travers le projet ?
Antonia :
J’ai fait la direction artistique et générale, c’est-à-dire la planification globale des étapes créatives et administratives du projet. Ensuite, j’ai invité mon collègue artiste et médiateur Nicolas Germain-Marchand à préparer et animer les ateliers avec moi. J’ai aussi pu mettre à profit mon expérience en cueillette et cuisine de plantes sauvages indigènes pour faire goûter aux participants plusieurs produits comestibles hyperlocaux, qu’ils soient découverts lors de nos balades ou cuisinés d’avance : limonade au sumac, pousses d’asclépiades vapeur, gâteau au mélilot, sirop d’épinette, confiture d’amélanches… On peut dire que tous nos sens ont été stimulés lors des ateliers !
Enfin, avec mon collègue musicien François Jalbert, j’ai capté des extraits sonores lors des ateliers et scénarisé deux mini-épisodes de balado afin de partager des extraits du projet avec une communauté plus large.
Mtl-MC : Ce dont vous êtes la plus fière ?
 Antonia :
Antonia :
La découverte de la nature de proximité est un moyen pour se reconnecter au reste du vivant, bien sûr. Mais j’ai été très touchée de voir à quel point nos activités permettaient aux voisins humains de créer des liens forts.
Voir un jeune immigrant dans la vingtaine raconter une histoire en théâtre d’objets devant d’autres citoyens, dans un français superbe, quand il s’agit de sa 3e ou 4e langue, c’est un moment très précieux. Je suis vraiment heureuse d’avoir réussi à faire se rencontrer des résidents de longue date de Montréal et des nouveaux arrivants à travers ce projet.
Mtl-MC : Le plus gros enjeu rencontré lors du
projet ?
Antonia :
L’enjeu principal fut la rétention des participants. Nous rêvions de créer une cohorte stable, qui verrait évoluer un même paysage au fil des saisons. La durée du projet sur plusieurs mois était un défi, et nous le savions, mais elle faisait aussi partie du rêve d’origine : se donner le droit de ralentir et de suivre la transformation de la nature, à son rythme à elle. Or, pour la population d’adultes immigrants que nous avons ciblée, la vie est très occupée et elle change vite : nouvel emploi, membre de la famille qui arrive au pays, enjeux de santé, etc. Il a donc été très difficile de préserver la cohorte complète au fil du projet.
Nous avons décidé d’ouvrir les 2 derniers ateliers à la communauté locale, immigrante ou non. Cela a nécessité une adaptation des activités offertes : présence d’enfants, participants différents à chaque atelier, etc. D’un autre côté, cela a permis des rencontres entre des habitants enracinés depuis des générations et d’autres qui bâtissent une nouvelle vie dans ce territoire. Ça a mené à des moments de partage très riches qui n’auraient pas existé dans la version d’origine du projet.
Mtl-MC : Quel impact a eu ce projet de médiation culturelle sur votre démarche artistique ?
Antonia :
 Les saisons enracinées, ce fut une succession d’instants de connexion profonde entre humains et plus qu’humains. Cela me confirme que la rencontre entre création artistique citoyenne et découverte de la nature urbaine est une voie porteuse pour bâtir les nouveaux récits collectifs dont nous avons tant besoin. Car le futur s’écrit toujours au présent. Il se construit au fil des gestes, des pratiques, des recettes, des récits que l’on bâtit ensemble.
Les saisons enracinées, ce fut une succession d’instants de connexion profonde entre humains et plus qu’humains. Cela me confirme que la rencontre entre création artistique citoyenne et découverte de la nature urbaine est une voie porteuse pour bâtir les nouveaux récits collectifs dont nous avons tant besoin. Car le futur s’écrit toujours au présent. Il se construit au fil des gestes, des pratiques, des recettes, des récits que l’on bâtit ensemble.
Par son accessibilité, son ludisme, son pouvoir émotif et sa pluralité d’approches, la médiation culturelle me semble un outil essentiel pour faire des citoyens des agents de changement à échelle locale et avoir un impact sur les enjeux cruciaux de notre époque. À l’avenir, j’aimerais continuer à explorer le potentiel de cette démarche et trouver comment bâtir une cohorte stable qui développerait une œuvre collective à offrir à sa communauté. J’espère que mes projets continueront à rendre visibles les mille manières qu’ont les humains d’habiter le monde avec joie, générosité, imagination et tendresse.
Mtl-MC : Quel est le plus gros tabou en médiation culturelle, ou ce que vous vivez dont on ne parle jamais ?
Antonia :
Sa puissance. Quand la confiance s’installe, surtout avec des populations vulnérables, on reçoit des témoignages hyper touchants, et parfois très durs. C’est admirable que l’art permette à des citoyens de s’ouvrir, parfois pour la première fois, et de livrer leur parole. Mais en tant qu’artistes, nous ne sommes pas toujours outillés pour soutenir les participants après leurs témoignages. Il faut trouver l’équilibre pour offrir notre empathie sans jouer un rôle d’intervention sociale qui n’est pas le nôtre, tout en prenant soin de la relation précieuse avec chaque personne.
Pour moi, le plus beau et le plus difficile en médiation culturelle, ce sont ces relations. Quand on crée des cohortes sur du moyen terme, vient toujours le moment où le projet se termine, et où ce lien qu’on a bâti arrête de se développer. Je trouve difficile de dire au revoir à ces groupes et individus qu’on a appris à connaître intimement, parfois en quelques semaines à peine. Mais bien sûr, les liens humains créés sont aussi le plus beau cadeau qu’offre chaque projet !
POUR ALLER PLUS LOIN
Découvrez les deux balados en ligne qui témoignent du projet :
Épisode 1 – Habiter en oiseau
Épisode 2 – Tissages du vivant
_
Ce projet réalisé pendant la deuxième année du programme Montréal culturelle, verte et résiliente (MCVR) bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.
_
crédit photo : Théâtre du Renard, 2024