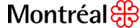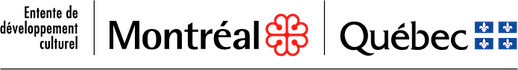Voix d’accès | 2e partie |
 Le 20 août 2024, nous avons rencontré Emily Laliberté et Mélina Desrosiers, les cofondatrices de Coup d’éclats, un organisme qui prône le pouvoir d’agir par l’art et la réflexion critique. De 2019 à 2023, en cocréation avec trois groupes de jeunes qui vivent des enjeux de santé mentale, elles ont réalisé Voix d’accès. Il s’agit du projet que nous avons présenté en première partie de ce reportage et qui a culminé par la publication d’un guide de survie intitulé : Trousse d’habiletés sociales, Assemblage de moyens de s’en sortir, les nôtres + les tiens.
Le 20 août 2024, nous avons rencontré Emily Laliberté et Mélina Desrosiers, les cofondatrices de Coup d’éclats, un organisme qui prône le pouvoir d’agir par l’art et la réflexion critique. De 2019 à 2023, en cocréation avec trois groupes de jeunes qui vivent des enjeux de santé mentale, elles ont réalisé Voix d’accès. Il s’agit du projet que nous avons présenté en première partie de ce reportage et qui a culminé par la publication d’un guide de survie intitulé : Trousse d’habiletés sociales, Assemblage de moyens de s’en sortir, les nôtres + les tiens.
Dans cette deuxième partie, nous vous invitons à plonger dans les coulisses du projet, à travers la réalité du terrain vécu par Mélina Desrosiers et Emily Laliberté en tant que médiatrices culturelles.
MONTRÉAL – MÉDIATION CULTURELLE : Maintenant que nous connaissons les détails de Voix d’accès, pouvez-vous nous dire quels étaient vos rôles et responsabilités en tant que médiatrices culturelles lors de ce projet ?
Mélina Desrosiers :
Selon notre approche, l’importance du savoir de chaque personne qui participe au projet est égale. Ce n’est pas le même savoir, mais chacun a autant de valeur que celui des autres. Emily et moi, on a des savoirs sur les œuvres en cocréation, les formes qui existent, comment guider les participantes et les participants, puis faire en sorte que l’œuvre soit bien reçue. Aussi, il y a tout le temps un intervenant ou une intervenante avec nous qui possède un savoir sur les rouages du système, ou sur certains enjeux plus spécifiques, ce qui nous aide à réfléchir. Car si on veut critiquer le système, il faut le connaître plus en profondeur pour réfléchir à la manière de le déjouer. Ensuite, les personnes participantes ont des savoirs expérientiels, qui ont envie de parler d’un sujet qui les touche, mais aussi des savoirs liés à leur propre sensibilité artistique. Notre rôle est de nous assurer de créer un tout avec les forces et les savoirs de chacun et chacune. On doit aussi garder une vision réaliste aux niveaux artistique et budgétaire, parce qu’on peut avoir toutes les ambitions du monde, il faut que quelqu’un ramène au réalisme. Ce qui inclut comment procéder pour avoir l’impact recherché.
Dans ce contexte, il y a toute la coordination, la réalisation des activités. Trouver des activités qui vont faire émerger du sens. Pendant l’animation, il faut s’assurer que tout le monde a sa place. Expliquer que les opinions divergentes sont importantes, mais qu’elles doivent être exprimées dans le respect. S’assurer que tout le monde peut parler. Il faut faire en sorte que tout le monde ait une manière de s’exprimer. Ça ne veut pas nécessairement dire par la parole ou par l’écrit. On veille à ce que tout le monde puisse se sentir valorisé dans le projet.
Emily Laliberté :
Tout ça demande de pouvoir constamment adapter : tu accueilles, tu orientes, tu encadres, tu adaptes. Ce projet est celui où j’ai été le plus challengée au niveau de l’accompagnement et de la cocréation. Habituellement, le cadre dans lequel on va cocréer, c’est l’aspect le moins remis en question et qui permet de faire émerger plein de choses qui vont servir pour la suite. Mais dans ce projet-là, le cadre a été redéfini pour chaque groupe, parfois pour chaque personne d’un même groupe. Le cadre de cocréation du comité d’édition a lui aussi dû être revu. Certains jeunes du comité en regardant les documents que d’autres jeunes avaient fait, trouvaient que c’était un peu bébé, ou que ça ne leur parlait pas. Mélina, qui travaillait avec ce groupe, a dû leur expliquer : « Toi, ta diversité, elle s’exprime de cette façon-là, mais Emily, elle a accompagné d’autres personnes, et leur diversité s’exprime autrement. » Donc, comme médiatrices, pendant le processus de coconstruction du résultat final, il fallait garder les gens dans un état d’esprit d’accueil, de flexibilité, d’interconnaissance.
Mélina :
Il y a aussi l’enjeu de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Avec le comité d’édition, par exemple, après chaque zoom on faisait un retour sur la rencontre. Certaines personnes pouvaient dire : « 3 h sur zoom, c’est trop intense à 7 h le soir. Moi, je peux pas faire ça le soir, ça serait mieux que ça soit le matin. » Alors on réfléchissait ensemble pour trouver comment s’arranger pour la prochaine fois. On avait aussi beaucoup de retour sur ce qui surchargeait et réfléchissait à des solutions : enlever la caméra, bloquer le son, ou encore quitter quand ça fait trop, pas grave. C’est important de s’assurer qu’il n’y a pas de surcharge, qu’on ne dépasse pas les limites des personnes. Les rencontres par Zoom apportaient de nouveaux défis, car il y avait la nuance du distant et du privé. D’habitude, l’espace des ateliers est neutre.
MTL-MC : Comment avez-vous évalué ce projet, quels outils avez-vous utilisés ?
Emily :
Dans les évaluations, on est obligées d’avoir du qualitatif et du quantitatif. Au niveau quantitatif, on avait dit qu’on allait avoir en moyenne douze jeunes par atelier. Ç’a été comme ça pour mes trois groupes. Avec la pandémie par contre, ç’a été plus difficile au niveau du comité d’édition, malgré toutes nos stratégies. En plus d’évaluer si les jeunes revenaient chaque semaine, on a évalué s’ils développaient un sentiment d’appartenance au projet. Au niveau du résultat final, on a évalué si les jeunes ressentaient une fierté, un sentiment d’appartenance. Ça, c’est super important en cocréation.
Au niveau qualitatif, on a évalué l’appréciation des activités de médiation, le sentiment d’apprendre des choses, de développer des nouvelles compétences, d’être reconnu pour ses compétences et son parcours de vie. On a évalué si le projet avait un impact positif sur l’estime de soi, un impact positif sur la santé mentale. Ça aussi c’est super important. Pendant les ateliers, il ne faut pas plonger les participantes et les participants dans un état de détresse. Nous, c’est pour ça qu’on travaille toujours en collaboration avec des intervenants et intervenantes.
Mélina :
Par exemple, à l’étape des ateliers d’édition avec le matériel amassé pour le livre, il y avait du matériel sur l’automutilation. On avait une intervenante sur place et les jeunes, s’ils voulaient sortir dehors pour jaser ou ventiler, c’était possible. Et c’est arrivé. Il y a des jeunes qui ont dit : « Ah, je feel pas ! » L’intervenante est sortie dehors, elle a jasé avec eux, elle a fait de l’intervention, pendant qu’on continuait à l’intérieur. Il y avait cet espace-là déjà prévu. On avait une personne qui avait cette responsabilité-là, d’encadrer, faire le suivi. C’est une intervenante qui travaille avec eux, du milieu. Après, pendant la semaine, les jeunes pouvaient aussi la contacter pour partager leurs commentaires, au besoin. Ensuite, l’intervenante nous faisait un suivi.
MTL-MC : Mélina a expliqué plus tôt qu’il y avait une auto-évaluation à la fin de chaque rencontre zoom avec son groupe, des jeunes qu’elle connaissait déjà depuis votre projet précédent de court-métrage documentaire. Toi, Emily, auprès de tes trois groupes de nouveaux participants et participantes, comment tu faisais l’évaluation ?
Emily :
À la fin de chaque cycle, je leur faisais faire une évaluation qualitative du processus sous forme de sondage. De mon côté, les marqueurs que je regardais à chaque atelier, c’était : est-ce que les gens reviennent, est-ce que les gens partent dans un bon état mental, est-ce qu’ils ont fait part de quelque chose aux intervenants. Mais dans les faits, pendant chaque atelier, chaque feedback est vraiment pour moi quelque chose qui fait partie du processus. Et si je ne suis pas capable de répondre aux besoins ou répondre à la demande qui m’est faite, je vais m’embarquer dans une réflexion afin de comprendre pourquoi le cadre n’était pas optimal. Parce que, même si avec l’expérience on a mis en place des règles et développé des procédures, on apprend de chaque processus cocréatif, car à chaque fois, on est confronté à des nouveaux défis.
MTL-MC : Avec ce projet, de quoi êtes-vous la plus fière ?
Mélina :
Parmi mes fiertés, il y a le sentiment d’appartenance développé par les jeunes. J’adore que les participants participantes disent « mon livre ». Entendre : « Hé notre livre es-tu prêt ? Est-ce qu’il est imprimé ? » Le jeune a l’impression que son travail à l’intérieur du projet est un vrai travail. Il est reconnu. C’était pas juste une « activité communautaire ». Je dis ça parce que des fois, c’est méprisé. Le sentiment d’avoir participé à une vraie œuvre, ça compte. Et je pense qu’une des choses qui quantifie ce sentiment d’appartenance, c’est la qualité de l’œuvre. Ça fait partie des budgets à prévoir, et de la réflexion à avoir quand on développe les projets. Il faut valoriser l’importance qu’on donne à la qualité de l’œuvre. Pour ce projet, le fait que ce soit un « vrai » livre, relié, en couleur, doux, qui peut être distribué, ç’a eu tout un impact sur la façon dont chaque personne se l’est approprié, et sur sa fierté envers le projet. La durabilité de l’œuvre finale donne de la valeur. Elle a un gros poids dans la fierté et dans l’appartenance au projet. Je considère aussi comme une réussite, et une fierté, que les jeunes inscrivent cette expérience dans leur CV. Qu’ils et elles envoient une candidature et disent : « Moi, j’ai travaillé au comité d’édition d’un livre. », c’est vraiment une réussite. On a bien joué nôtre rôle. Certains vont même nous écrire pour nous demander des conseils s’ils ont des idées de projets. D’autres ont envie de devenir médiateurs ou médiatrices. On devient un peu des mentors. Mais ça vient avec une responsabilité aussi.
 Emily :
Emily :
Pour moi, être arrivées au final à quelque chose de cohérent, qui se tient, qui est tellement à l’image de la diversité du processus et des différents chemins d’expression qui ont été nécessaires pour que tout le monde, avec sa diversité individuelle, ait été capable de s’exprimer, de briller et d’être reconnu dans le processus, c’est ma plus grande fierté. Avec mes groupes, j’ai dû être méga créative à chaque instant, dans l’accueil des besoins individuels. Tout un défi d’adaptation continuelle qui a engendré des créations inattendues, comme le soir où j’ai dit à une participante : « Toi, ce soir, ça te tente pas de faire ça ? Qu’est-ce que t’as envie de faire alors ? » Elle m’a répondu : « J’ai envie de faire un dessin pour parler de mes Meltdowns, parce que c’est quelque chose que je trouve vraiment dur à vivre. » Et là, la jeune fille fait une chose formidable, elle fait un dessin sur sa façon de gérer ses moments difficiles. Un dessin avec elle la tête par en haut, puis l’autre avec la tête par en bas. Un véritable mode d’emploi pour que les personnes neurotypiques sachent comment entrer en relation avec une personne autiste, et quoi faire lors d’un Meltdown.
MTL-MC : Quel a été le plus gros enjeu rencontré lors du projet ?
Emily :
La durabilité de l’œuvre et le sentiment d’appartenance dont a parlé Mélina viennent avec le défi majeur qu’est le financement. Ç’a quand même été ça le plus gros enjeu du projet. Parce que la cocréation, historiquement, était vue comme une approche d’art communautaire. Aujourd’hui, avec des artistes sociaux, participatifs ou en art relationnel qui travaillent aussi sur des démarches de cocréation dans des contextes de médiation, il s’est développé une volonté de créer des œuvres de qualité professionnelle pour être capable d’atteindre un impact social, un rayonnement, une visibilité de la voix des personnes. On n’est plus dans la trace d’un processus de médiation culturelle. On est bien au-delà.
Les processus de financement public en art ne sont pas adaptés à la cocréation. Quand tu regardes les cases, c’est complexe, un vrai casse-tête. Parce que selon la source de financement, elle ne soutient pas nécessairement les participations inclusives, alors que nous, on veut éthiquement reconnaître nos cocréateurs comme des créateurs. On n’est pas en train d’essayer de se faire accroire que c’est des pauvres petites personnes qui participent à des projets sociaux. Il faut donc qu’on trouve des enveloppes ailleurs, pour leur donner quelque chose qui ressemble à un cachet. On leur fait des contrats de cocréateurs parce qu’on ne veut pas faire de profits sur leur travail. Par contre, il faut qu’on finance nos activités. Donc, comment faire ? Les fonds publics qui soutiennent la médiation soutiennent la médiation, mais ne soutiennent pas la production. Quand tu as une approche de cocréation éthique, tu te retrouves en permanence assise entre deux chaises. Parce que du côté des artistes professionnels, vu que tu travailles avec des non-artistes, ils ne considèrent pas que c’est de l’art. Du côté de la médiation, ils considèrent seulement la partie de travail qui se situe dans la relation de la médiation. Et ils ne veulent pas qu’on paye les participants.
Mais si on veut être honnête, si on veut parler de démocratie culturelle, on doit avoir une position éthique claire. Dans le processus de cocréation entre des artistes professionnels et des participants participantes, je trouve que la question éthique est là en permanence, parce que sinon les artistes c’est des extractivistes qui vont chercher les idées et les expériences de vie, font œuvre et bonifient leur propre portfolio avec ça. Il y a un coût à la posture éthique de la cocréation, et, douze ans plus tard, ça ne trouve toujours pas sa place. Je le sais bien, parce que je m’occupe du montage financier de ces projets-là depuis 2010. Je dois cumuler les enveloppes pour arriver à faire le travail qu’on veut faire.
Mélina :
On est super fières du résultat de notre projet, mais il y a un coût à ce résultat. On est super contentes de la subvention de la Ville, mais ce n’était pas suffisant pour aboutir au livre, à l’objet final. Avec la pandémie, la Ville ne nous a jamais demandé de finir le livre, parce que les circonstances externes étaient contre nous. Mais pour nous, éthiquement, c’était impensable de ne pas le finir. On avait une responsabilité envers les personnes qui avaient participé. La responsabilité de ce qu’on leur avait dit, qu’on allait faire briller leur voix, qu’on allait avoir un impact. Il fallait qu’on le fasse ce livre.
Emily :
On a eu un soutien non négligeable de Sagamie. On a travaillé en collaboration avec l’organisme, en signant une entente qui nous donnait accès à l’équivalent de 5 000 $ de travail graphique gratuit, en étant partenaires d’édition du projet. Pour arriver au résultat final, on avait besoin de ça. On y est arrivées grâce à beaucoup de collage : du collage d’argent, du collage de moyens. Et nous, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévolat.
Mélina :
Les jeunes du comité d’édition ont été rémunérés, mais pas avec le soutien de la Ville de Montréal. On est allé chercher un don de la députée Manon Massé. Parce que ces jeunes avaient déjà travaillé avec moi pour la cocréation du film documentaire. À ce moment-là, ils avaient été payés par le groupe de recherche ACCESS. Alors c’était vraiment bizarre de leur dire : « Maintenant, venez travailler avec moi, mais là, vous allez avoir zéro. » C’était pendant la pandémie, alors qu’on parlait de précarité, des personnes en situation d’itinérance qui cherchaient du travail. Ne pas les rémunérer, c’était impossible ! Alors on est allé chercher une enveloppe. L’augmentation des coûts a fait qu’ils étaient rémunérés 15 $ de l’heure, jusqu’à ce que l’enveloppe soit vide. On leur disait : « On peut vous payer tant d’heures, il faut réussir à produire ce qu’on veut faire dans ce temps-là. » Quand on parle de valorisation, pour eux, c’était un travail. Il y avait un horaire. Ils me demandaient parfois : « C’est quand la prochaine fois qu’on se réunit, juste pour que je gère mon budget. » Ça nous avait déjà été dit par les jeunes que pour eux, c’était quelque chose d’important d’être rémunérés dans ces projets-là.
MTL-MC : Y a-t-il une réalité que vous vivez en médiation et dont on ne parle jamais ?
 Mélina :
Mélina :
En médiation culturelle, on travaille avec des populations marginalisées qui vivent de la précarité, mais souvent les médiateurs et médiatrices, on est en état de précarité parce que les budgets sont des petites enveloppes. La médiation entre les travailleurs culturels et les participants est financée, mais finalement, tout le monde se maintient dans la précarité. C’est difficile de garder cet emploi à long terme. C’est pour ça que je suis dans un processus de changement de milieu.
Emily :
Je suis dans cette réflexion-là moi aussi actuellement, parce que ç’a eu d’énormes impacts sur ma santé financière, sur ma vie et ma santé mentale. Ma tentative d’être directrice d’un organisme, de créer mon projet, n’a pas réglé mon enjeu de précarité. Avec toutes les meilleures intentions du monde, j’ai quand même créé de la précarité. Le financement par projet, ça ne fonctionne pas. Peu importe où on est sur le spectre de la cocréation, de la médiation, de la création artistique, du milieu communautaire, on est tous dans le même bateau. L’épuisement est généralisé parce qu’on se retrouve à faire plein de projets en même temps pour être capables de payer notre loyer. Et comme on a des grands idéaux aux niveaux de la qualité, de l’éthique et des processus, on ne laisse rien tomber. Mais au final, les contrecoups sont très forts sur nous-mêmes. On s’épuise. Et quand tu ne prends pas soin de toi-même, malheureusement, c’est pas vrai que t’es une bonne accompagnatrice. En ce moment, le bien-être émerge beaucoup dans les thématiques abordées par les artistes et je ne pense pas du tout que ce soit anodin.
Mélina :
Il y a tellement peu d’argent investi dans le communautaire. On travaille avec des jeunes qui n’ont pas de logement ou qui ont d’autres besoins essentiels. On se retrouve à pallier le sous-financement en intervenant auprès de cette communauté-là parce qu’il n’y a pas assez de filet social. Des projets comme le livre ne coûtent pas grand-chose au gouvernement finalement, pour aller repenser le système.
Emily :
On assume une responsabilité de défense des droits de la société civile. On a un rôle social hyper important, mais c’est minimisé à de l’animation culturelle. Ce qu’on fait va bien plus loin que ça.
Mélina :
C’est que la médiation culturelle a un impact et un rôle beaucoup plus grands dans la société que ceux qu’on lui reconnaît. C’est sous-estimé. Avec un projet comme le livre, on a vraiment eu un impact sur les citoyens de demain. Il y a des conséquences positives qui découlent de ces projets-là. On oublie que tout ça a aussi une valeur, pas juste les dix ateliers de médiation. Il faudrait que le financement soit à la hauteur de la portée réelle des projets et de tout le processus. Et que les médiateurs et médiatrices aient une rémunération adéquate.
Emily :
Comme personne qui a eu son organisme, j’ai aussi nourri la bête. Parce qu’on veut tellement les faire ces projets-là. On a tellement une urgence de dire, de créer, d’avoir un impact de transformation sociale. Alors, quand on voit des appels de projets à 5 000$, 10 000 $, 15 000 $ on a le réflexe de se dire c’est mieux que rien, et, qu’avec des bouts de chandelles, on va s’organiser pour faire quelque chose, parce qu’il y a cette urgence. Au final, on participe au sous-financement parce qu’on arrive avec notre super résultat de projet, et que, dans la grille de retour budgétaire, on dit que ça a coûté ce qu’on avait dit que ça allait coûter. Parce que tout le reste, c’est du dépassement de coûts qui est invisible. C’est fait bénévolement, mais ça a un coût humain.
MTL-MC : Encore une fois, merci à vous deux pour votre grande générosité à nous partager votre expérience du terrain en médiation culturelle et à soulever ces enjeux. [Retrouvez la 1ère partie de reportage ici]
_
Ce projet bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.
_
crédit photo : Coup d’éclats
propos recueillis par Sylvaine Chassay